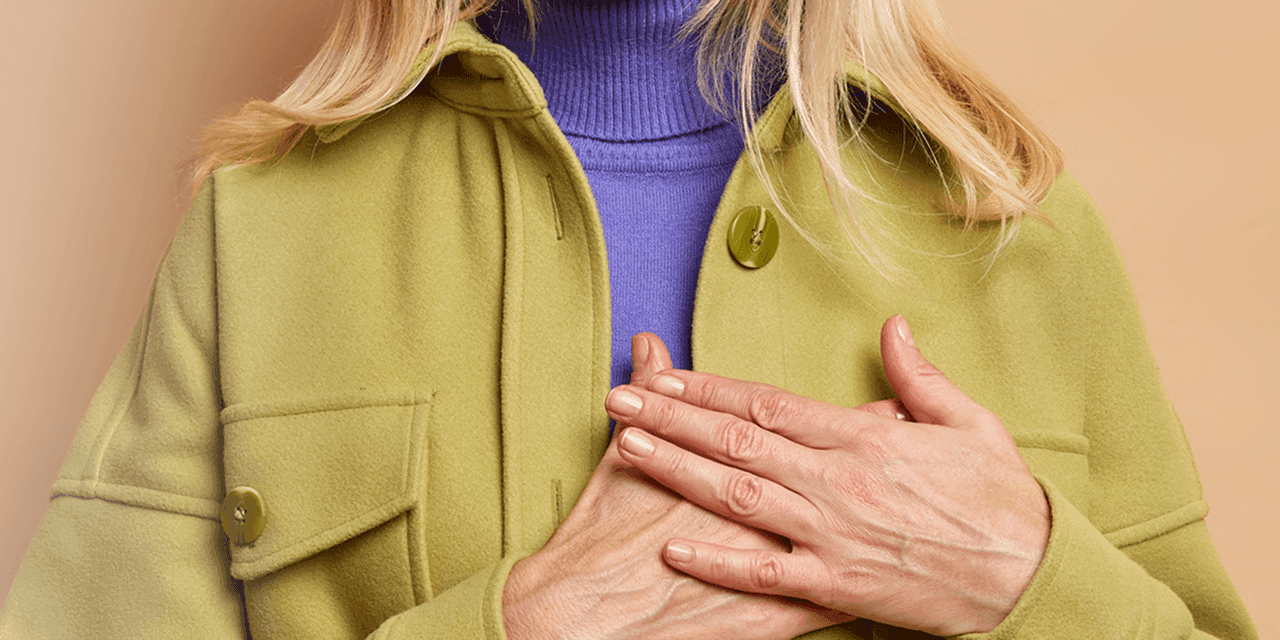Orientation, information, accompagnement
Maladies chroniques : êtes-vous concerné ?Par Marion Berthon le 07/12/2020
Revue par le Pr Yves Alimi, Chirurgien vasculaire
Mise à jour le 25/04/2025
La phlébite, ou thrombose veineuse, est une maladie cardiovasculaire qui se traduit par l’apparition d’un caillot de sang dans une veine. Ce caillot peut obstruer n’importe quelle veine, mais dans la très grande majorité des cas, ce sont celles situées dans les jambes qui sont affectées en priorité. Pour autant, les membres supérieurs ou l’abdomen ne sont pas exemptés. On parle de phlébite dès lors qu’un bouchon se forme dans la veine et empêche - partiellement ou totalement - le sang de circuler.
Selon le calibre et l’emplacement de la veine concernée, on distingue les phlébites superficielles des phlébites profondes. La forme la plus courante de la pathologie est la phlébite superficielle. Elle concerne les veines dites de surface, de moins gros calibre. Si elle ne représente pas une urgence absolue, ce type de phlébite doit toutefois alerter le patient car cette pathologie cache souvent une insuffisance veineuse avancée.
La phlébite profonde, quant à elle, concerne les veines de plus gros calibre, qui présentent un débit sanguin important. Le risque est alors de voir le caillot sanguin se décrocher de la paroi veineuse et d’être emporté vers le cœur et obstruer l’artère pulmonaire. La phlébite profonde peut conduire à une embolie pulmonaire, pathologie potentiellement mortelle. Environ 30% des patients atteints de phlébite profonde développent une embolie pulmonaire. Il s’agit d’une complication grave, survenant lorsque le caillot de sang formé dans la veine profonde se détache et migre vers les poumons, entraînant une obstruction des artères pulmonaires. Les symptômes d'une embolie pulmonaire peuvent inclure une douleur thoracique, une toux avec ou sans sang, une respiration rapide, des vertiges, une faiblesse ou une fatigue, des battements cardiaques rapides et des sueurs. Le risque est d’autant plus élevé pour les personnes ayant des antécédents de phlébite, les personnes âgées, les fumeurs, les personnes obèses, les femmes enceintes et celles ayant des troubles de la coagulation sanguine.
Profonde ou superficielle, chacun de ces deux types de phlébite appelle un traitement différent.
Facteurs de risque de la phlébite
Dans un cas sur deux, la phlébite peut survenir de façon spontanée, sans que l’on sache expliquer pourquoi. Toutefois, des facteurs de risques existent. Notre organisme fabrique naturellement et en permanence des micro-caillots sanguins. Leur rôle est de colmater une brèche dans une paroi veineuse, en cas d’hémorragie par exemple. En parallèle, notre sang contient également des substances qui bloquent la coagulation. Ces substances, alliées à une bonne circulation sanguine, empêchent les micro-caillots de trop grossir. De cette façon, un équilibre se crée. Mais dès qu’un problème vient altérer la circulation sanguine ou le processus de coagulation, alors l’équilibre est rompu. On a ainsi identifié plusieurs facteurs susceptibles de favoriser l’apparition d’une phlébite. Une immobilisation prolongée, par exemple, accroît ce risque car elle entraîne une stagnation du sang dans la veine. Il en va de même pour une insuffisance veineuse ou cardiaque. Un cathéter peut provoquer une inflammation de la veine, et est également susceptible de favoriser la maladie. Certaines pathologies (cancéreuses ou génétiques) qui accélèrent la coagulation du sang font également parties des facteurs aggravants. On estime qu’il y a chaque année, 1,5 cas pour mille personnes atteintes de phlébite profonde en France (soit environ 99 000 cas).
La phlébite, et en particulier la phlébite profonde, est une maladie dangereuse dans la mesure où elle fait courir un risque majeur d’embolie pulmonaire, aux conséquences parfois fatales pour le patient. Mais la phlébite profonde est également néfaste par les séquelles à long terme qu’elle peut engendrer. C’est le cas de la maladie post-thrombotique, une maladie chronique et invalidante qui se traduit notamment par des complications cutanées. Dans ce contexte, un deuxième avis est pertinent car il permet au patient de s’informer de la façon la plus complète possible sur les implications, les conséquences et les traitements de sa maladie. Ainsi éclairé, il peut prendre part de façon active à la stratégie thérapeutique qui lui est proposée. Mieux informé, il peut également adopter les comportements appropriés pour réduire les risques de complications et garantir un meilleur résultat au traitement. La phlébite est une maladie qu’il faut bien comprendre si l’on veut optimiser sa prise en charge.
Mais aussi toutes les autres questions spécifiques que vous vous posez.
Dans le cadre d’une phlébite, il faut consulter un phlébologue ou angiologue. C’est le spécialiste des maladies veineuses et de leur traitement.
L'autre médecin référent pour la phlébite est un médecin ou chirurgien vasculaire. Celui-ci est un spécialiste des problèmes des vaisseaux (artères, veines, vaisseaux lymphatiques).
Les premiers signes d’une phlébite
Les symptômes d’une phlébite superficielle sont visibles à l’œil nu : la veine prend une teinte rouge et la zone peut être sensible lorsqu’on la touche. Une sorte de cordon douloureux suit le trajet de la veine. Parfois, un œdème prend forme localement.
Les symptômes d’une phlébite profonde sont nettement moins visibles. La veine étant par définition « profonde », l’inflammation ne se voit pas en surface. Il arrive que la maladie ne présente aucun symptôme, d’où sa dangerosité. Toutefois dans la moitié des cas, les patients ressentent une douleur latente dans la jambe, associée ou non à des engourdissements et des crampes. Une sensation de chaleur envahit la jambe qui peut gonfler sous l’effet d’un œdème. La peau prend parfois une coloration bleutée. Ces symptômes peuvent être accompagnés de fièvre.
On ne diagnostique pas une phlébite superficielle de la même façon qu’une phlébite profonde. Dans le premier cas, un simple examen clinique peut suffire. Par précaution, le médecin préconisera néanmoins un examen d’imagerie médicale pour s’assurer qu’aucun caillot n’est en train de se former dans les veines profondes.
A elles seules, la palpation et la vue ne permettent pas d’établir un diagnostic de phlébite profonde. Ce diagnostic requiert de pratiquer un écho-Doppler. Cet examen d’imagerie médicale permet d’analyser le débit sanguin et de détecter une éventuelle anomalie. Enfin, une analyse des D-dimères (l’un des principaux constituants des caillots sanguins) est parfois pratiquée pour préciser ce diagnostic. Plus le taux de D-dimère est élevé, plus le risque d’être en présence d’un caillot sanguin est important. Enfin, il est désormais établi que la pilule, mais aussi le tabac ou encore les traitements contre la ménopause aggravent les risques de voir des caillots sanguins se constituer.
Le choix du traitement dépend :
Traitement d’une phlébite superficielle
Il n’y a pas de recommandation précise sur le traitement d’une phlébite superficielle. Néanmoins, les médecins préconisent de suivre un traitement qui associe des anti-inflammatoires non stéroïdiens et le port de bas de contention, pour prévenir les complications. Des anticoagulants peuvent également être administrés. Par précaution, les médecins effectuent toujours une vérification des veines profondes au moyen d’un écho-Doppler, pour s’assurer qu’il n’existe pas une phlébite profonde asymptomatique sous-jacente. Parfois, un traitement chirurgical destiné à retirer des varices peut être également proposé.
Traitement d’une phlébite profonde.
Cette pathologie requiert un traitement sans délai, qui repose en priorité sur des anticoagulants. Ceux-ci peuvent être administrés par injection sous-cutanée (comme l’héparine), ou par voie orale (comme les antivitamines K). Souvent le médecin prescrit successivement l’un, puis l’autre, car le traitement d’une phlébite profonde peut durer plusieurs mois, voire indéfiniment, dans les cas les plus sérieux. Il doit être associé à des contrôles biologiques réguliers, qui ont pour but de vérifier que la dose d’anticoagulants prescrite est adaptée au patient. Ceci afin d’éviter les risques d’hémorragie. En parallèle, le port de bas ou de chaussettes de contention (pendant environ 3 mois) est indispensable pour éviter les risques de complication.

Radiologue interventionnel
Hôpital Américain de Paris

Médecin vasculaire
CHRU Brest - Hopital de la Cavale Blanche


Orientation, information, accompagnement
Maladies chroniques : êtes-vous concerné ?Par Marion Berthon le 07/12/2020