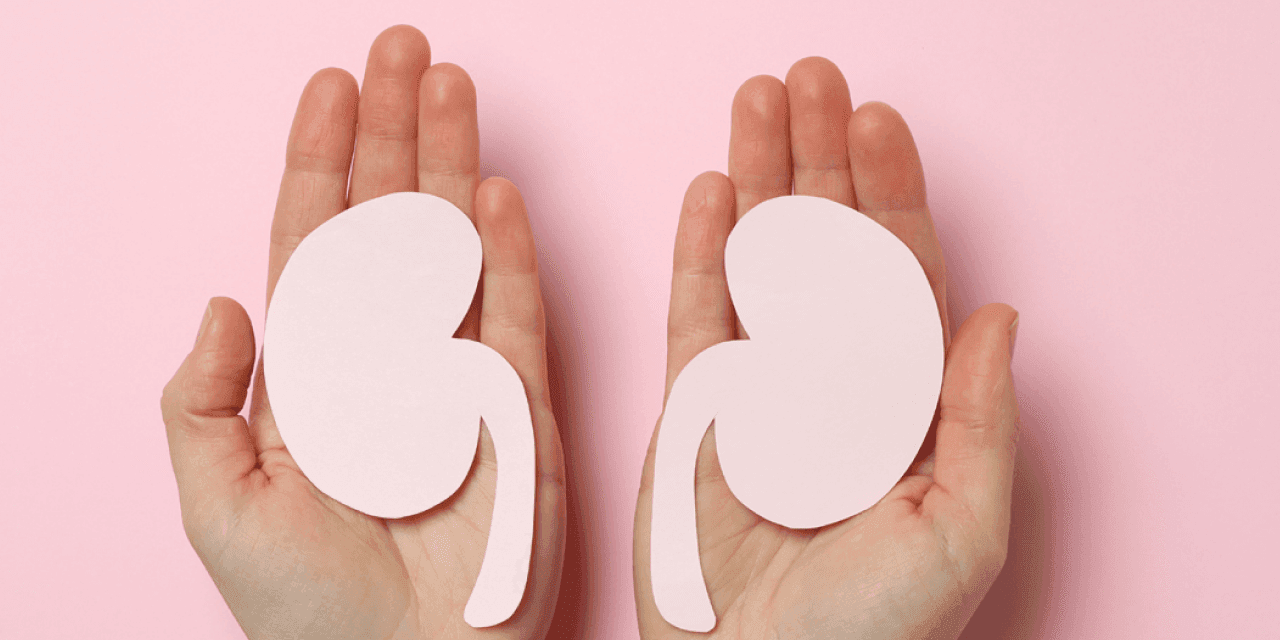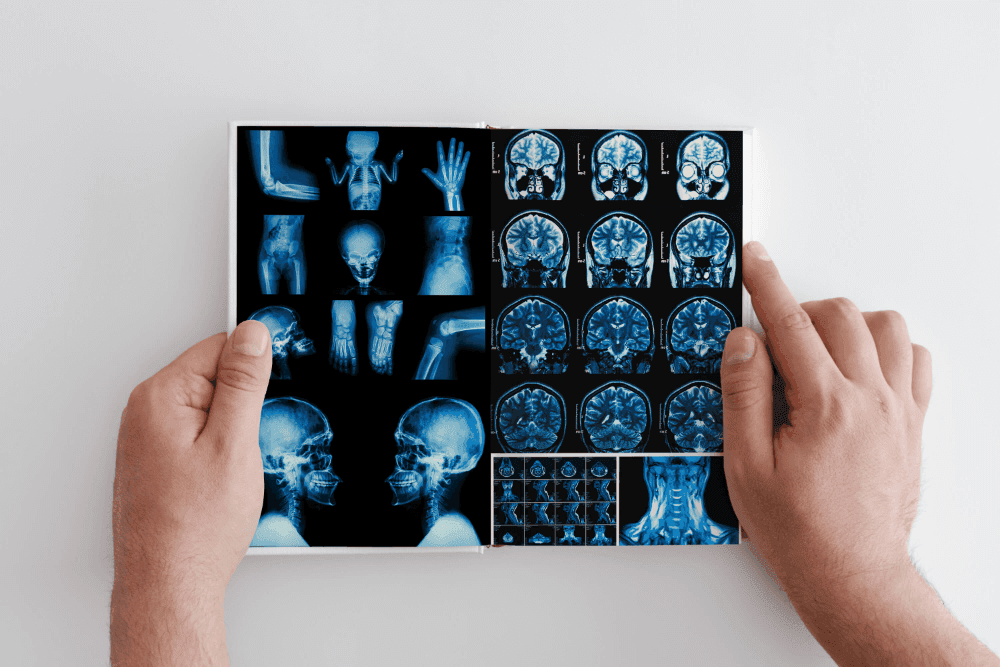
Anévrisme intracrânien non rompu
Revue par le Dr Bertrand Mathon, Neurochirurgien
Mise à jour le 28/03/2024
Qu'est-ce qu'anévrisme intracrânien non rompu ?
Un anévrisme intracrânien est une malformation d’une artère cérébrale qui correspond à une dilatation focale de la paroi de cette artère intracrânienne. Au sein de cette « poche », le sang circule sous pression. La caractéristique commune des anévrismes est la fragilité de leur paroi qui peut les amener à grandir au fil du temps voire à se rompre. Les anévrismes ont des morphologies variables pouvant être dans la majorité des cas sacciformes (c’est en dire en forme de sac), ou bien fusiformes (en forme de fusée) ou multilobulés. Leur taille est variable, on décrit des anévrismes petits (<10 mm), larges (>10mm) et géants (>25mm). La prévalence dans la population générale varie de 2 à 6 %.
Le ou les mécanismes de la naissance et de la croissance des anévrismes restent encore inconnus. Ils se forment en regard d’une zone de faiblesse de la paroi de l’artère, le plus souvent au niveau des bifurcations des artères du cerveau. Certains facteurs endogènes sont associés à une augmentation de la prévalence des anévrismes intracrâniens : les antécédents familiaux d’anévrisme intracrânien et certaines maladies génétiques ou auto-immunes. L’hypertension artérielle chronique, le tabac et l’intoxication alcoolique chronique sont des facteurs reconnus d’augmentation du risque de rupture et de croissance anévrismale.
Lorsqu’un anévrisme se rompt, le sang préalablement contenu dans les artères intracrâniennes se répand au sein des enveloppes qui entourent le cerveau (les méninges), on parle alors d’hémorragie méningée. Les conséquences sont gravissimes puisque: 10% des patients qui présentent une hémorragie méningée vont décéder d’emblée, 30 à 50 % des patients décéderont dans les trois mois et 30 % des patients présenteront un handicap définitif.
Quel est l'intérêt d'un deuxième avis pour un anévrisme intracrânien non rompu ?
Pourquoi demander un deuxième avis pour un anévrisme intracrânien non rompu ?
La rupture d’un anévrisme intracrânien peut engager le pronostic vital ou dégrader sérieusement la qualité de vie de celui qui le porte. Il convient de le prendre en charge dès son diagnostic. Toutefois, il faut aussi prendre le temps de voir si une simple surveillance est possible, sans nécessairement passer par un traitement chirurgical ou endovasculaire. Tout l’enjeu est donc de mesurer au mieux le rapport entre les avantages et les risques de tel ou tel traitement. Dans ce contexte, un deuxième avis est tout à fait pertinent. Il permet au patient de recevoir l’information nécessaire pour prendre part, de manière éclairée, à l’élaboration d’une stratégie thérapeutique adaptée à sa situation.
Quelles sont les questions les plus fréquemment posées pour un anévrisme intracrânien non rompu ?
- Quel est mon risque de rupture d’anévrisme ?
- Faut-il traiter mon anévrisme ?
- Quelle est la technique la mieux adaptée au traitement ?
- En quoi consistera l’intervention ?
- Quels sont les risques de l’intervention ?
- Quelle sera l’évolution en l’absence d’intervention ?
Mais aussi toutes les autres questions spécifiques que vous vous posez.
Quels sont les spécialistes de l'anévrisme intracrânien non rompu ?
Un neuroradiologue interventionnel. C’est lui qui réalise les bilans diagnostiques des anévrismes intracrâniens (artériographie cérébrale, angioscanner cérébral) et qui réalise leur traitement endovasculaire. Un neurochirurgien spécialisé dans les pathologies vasculaires. C’est lui qui posera l’indication opératoire et qui réalisera l’intervention.
Il existe une filière santé maladies rares qui s’occupe des maladies rares du système nerveux central, et qui traite du syndrome les anévrismes intrcrâniens non rompus : Brain Team. Pour savoir ce qu’est une filière de maladies rares, mieux connaître Brain Team et identifier ses centres de prise en charge, rendez-vous sur notre article de blog : A qui s’adresser en cas de maladie rare du système nerveux central.
Quels sont les symptômes d'un anévrisme intracrânien non rompu ?
Rupture d’anévrisme : C’est le risque principal risque. La rupture se manifeste par de violents maux de tête très intenses, inhabituels, d’installation brutale. Cette violente céphalée est due à l’irruption de sang autour du cerveau (hémorragie méningée) qui entraîne une augmentation brutale de la pression intracrânienne pouvant aller jusqu’au coma.
Découverte fortuite : Enfin, la découverte d’un anévrisme peut se faire par hasard sur un examen d’imagerie (angioscanner ou angio-IRM) réalisé pour une autre indication.
Compression neurologique : Bien que cela soit très rare, dans d’autres cas, le tableau clinique peut être plus progressif, due à la compression d’une structure nerveuse intracrânienne par un anévrisme de grande taille se manifestant alors par un déficit neurologique non spécifique de type vision double, baisse de l’acuité visuelle, trouble de la parole ou autres...
Comment diagnostiquer un anévrisme intracrânien non rompu ?
Après un premier bilan clinique, le médecin procède à des examens d’imagerie médicale. L’angioscanner (ou angio-IRM) est l’examen de première intention. C’est un examen non invasif qui permet de visualiser l’anévrisme. L’artériographie cérébrale est l’examen de référence qui permet une reconstruction en 3D des artères du cerveau et la planification du traitement de l’anévrisme.
Comment soigner un anévrisme intracrânien non rompu ?
Le choix du traitement dépend :
- De la taille de l’anévrisme
- De la localisation de l’anévrisme
- De la topographie de l’anévrisme
- De l’existence de signes neurologiques
- De l’existence d’antécédents d’anévrismes dans la famille
- D’éventuelles autres pathologies associées
- De l’âge du patient
- De ses antécédents médicaux et familiaux
- De son état de santé général
Les différents traitements
Les indications de traitement sont différentes s’il s’agit d’un anévrisme rompu ou non :
- En cas d’anévrisme rompu, le traitement doit être réalisé en urgence et devant tout type d’anévrisme rompu.
- En cas d’anévrisme non rompu, la décision thérapeutique sera discutée au cas par cas, en consultation avec un médecin neuroradiologue interventionnel et/ou un neurochirurgien. Le but de la consultation est d’évaluer le risque de rupture anévrismale et de la rapporter au risque lié à l’intervention. A l’aide de l’imagerie réalisée au préalable, le médecin notera la taille et la topographie de l’anévrisme, l’âge du patient, les antécédents (HTA, Tabac, antécédents personnels ou familiaux d’anévrisme ou d’hémorragie méningée).
Le but du traitement est d’exclure l’anévrisme de la circulation artérielle. Il existe deux options thérapeutiques : le traitement par voie endovasculaire et le traitement neurochirurgical par chirurgie ouverte. Le choix thérapeutique dépendra de plusieurs facteurs (taille et topographie de l’anévrisme, choix du patient, expérience de chaque centre) et sera décidée au cas par cas pour chaque patient.
Traitement endovasculaire : le geste est réalisé par un neuroradiologue interventionnel. Le praticien cathétérise une artère périphérique (l’artère fémorale le plus souvent) puis introduit un micro cathéter (petit tuyau) et le dirige jusqu’à l’intérieur du sac anévrismal. Lorsqu’il est en position, le médecin introduit à l’intérieur du cathéter des « coils » (spirale de platine) qu’il déploie directement à l’intérieur de l’anévrisme pour l’occlure tout en laissant perméable l’artère porteuse de l’anévrisme. D’autres techniques, comme la pose d’un stent intracrânien, permettent de traiter des anévrismes particulièrement complexes par voie endovasculaire.
Traitement neurochirurgical : le geste est réalisé par un neurochirurgien. Le praticien accède à l’anévrisme en réalisant une craniotomie. Le traitement se fait à l’aide d’un « clip » chirurgical posé à la base de l’anévrisme.
Le traitement neurochirurgical est plus invasif que le traitement endovasculaire, mais le risque de récidive (reperméabilisation) de l’anévrisme est plus faible quand celui-ci est traité chirurgicalement.
Grâce à votre contrat santé ou prévoyance, obtenez l’avis d’un médecin expert de votre problème de santé en moins de 7 jours, gratuitement et sans avance de frais

Découvrez nos conseils santé sur notre blog chaque semaine
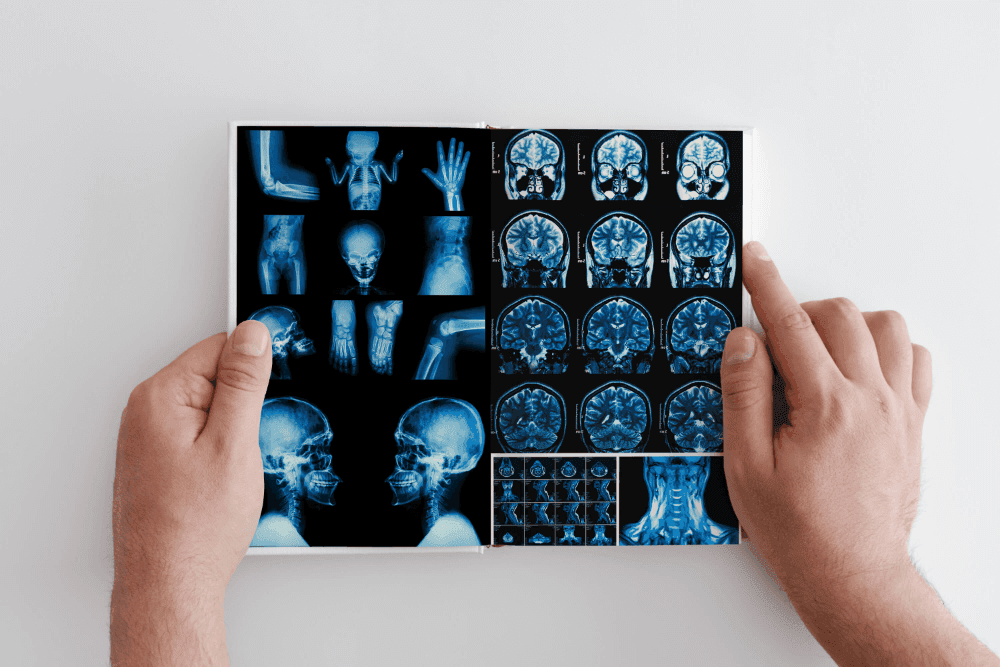
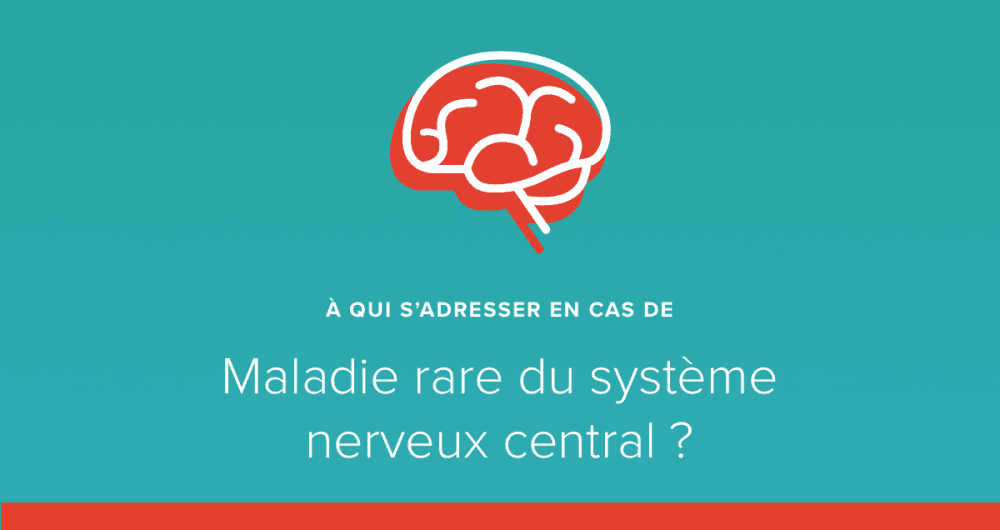
Maladie rare, maladie orpheline
A qui s'adresser en cas de maladie rare du système nerveux central ?Par Joséphine de Becdelièvre le 13/12/2018

Découvrez nos webinaires
Vous avez manqué un webinaire ?
Maladies neurovasculaires :
- Accident ischémique transitoire
- Algie Vasculaire de la Face
- Angiopathie amyloïde
- Céphalées de tension
- Démence vasculaire
- Hématome sous-dural chez l'enfant
- Hématome sous-dural chronique
- Hydrocéphalie chronique
- Infarctus cérébral
- Malformation artérioveineuse intracrânienne non rompue
- Migraine
- Migraine hémiplégique
- Cavernome
- Thrombophlébite cérébrale
- Traumatisme crânien
- Fistule artérioveineuse