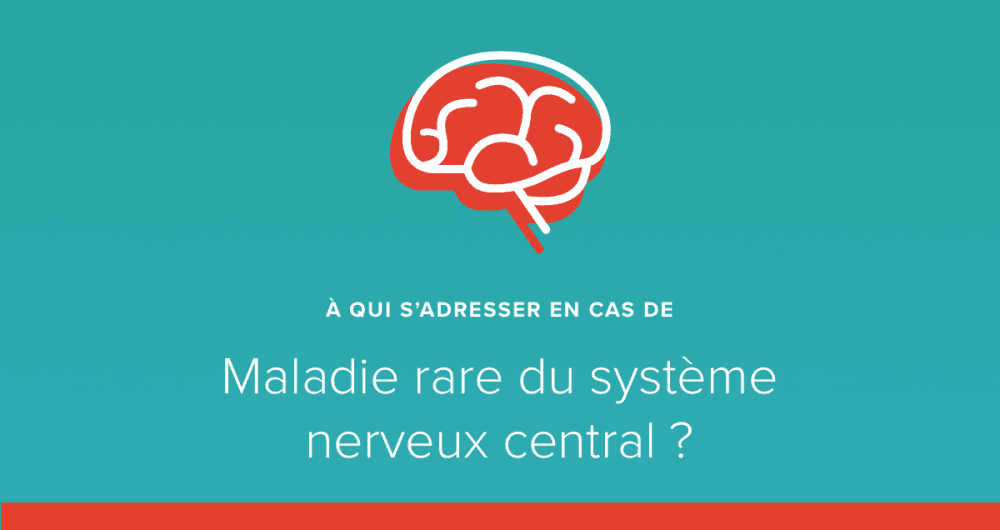
Maladie rare, maladie orpheline
A qui s'adresser en cas de maladie rare du système nerveux central ?Par Joséphine de Becdelièvre le 13/12/2018
Revue par le Dr Bertrand Mathon, Neurochirurgien
Mise à jour le 28/03/2024
Le cavernome est également appelé angiome cérébral. Il s’agit d’une malformation des vaisseaux sanguins du cerveau, qui se dilatent et s’agglomèrent de façon anormale, sous la forme de petites cavités, ou cavernes (d’où leur nom). Concrètement, le cavernome prend plus ou moins la forme d’une mûre, et est constituée d’une multitude de petits vaisseaux enchevêtrés. La taille d’un cavernome peut varier de quelques millimètres à plusieurs centimètres.
La principale complication d’un cavernome est qu’il risque d'entraîner un saignement, lequel se produit, le plus souvent, à l’intérieur dudit angiome cérébral. Cependant les parois du cavernome sont fragiles et peuvent se rompre sous la pression. Le saignement se poursuit alors à l’extérieur et on assiste à une hémorragie cérébrale qui peut endommager les structures alentour. La fréquence de cette complication est estimée à 3% des cas par an. Quand il ne saigne pas, le cavernome peut également entraîner des troubles neurologiques. L’atteinte neurologique la plus fréquente est l’épilepsie. En effet, les cavernomes sont souvent situés dans des régions du cerveau qui provoquent de l’épilepsie. Dans une minorité de cas, cette épilepsie peut résister aux médicaments antiépileptiques. On parle alors d’”épilepsie pharmacorésistante”. Toutefois, seule une petite minorité des cavernomes (10%) provoque des troubles. La grande majorité des cavernomes reste silencieuse. C’est pourquoi, bon nombre de personnes ignorent qu’elles sont porteuses de cette anomalie.
On connaît mal l’origine d’un cavernome. Dans 80 % des cas, il s'agit d'une anomalie qui survient par hasard et peut être découverte fortuitement si elle ne se traduit par aucun symptôme. Les 20 % restants sont d’origine génétique, et se transmettent par le mode autosomique dominant (la moitié des descendants portera le gène malade). Cette forme familiale de cavernome est la conséquence de la mutation d’un gène, qui jouerait un rôle dans la formation des vaisseaux sanguins chez l’embryon.
On estime qu’en France, le nombre de personnes porteuses d’un cavernome non génétique se situe entre 1 cas sur 1000 et 1 cas sur 200, ce qui en fait une anomalie très fréquente. Les cavernomes touchent majoritairement l’adulte et on les découvre en général entre 30 et 40 ans. Ils affectent autant les hommes que les femmes et représentent entre 5 et 10 % de l'ensemble des malformations vasculaires cérébrales.
Dans le cadre d’un cavernome, un deuxième avis semble tout à fait pertinent, compte tenu de la délicatesse d’une intervention sur le cerveau. Même si les progrès de la médecine ont considérablement réduit le risque de complication, la chirurgie du cerveau n’est pas sans risque et certaines zones du cerveau peuvent subir des dommages irréversibles. Il est donc nécessaire, avant de prendre une décision, de bien comprendre les enjeux de l’opération, mais aussi les complications potentielles que peut engendrer votre cavernome, afin d’évaluer au mieux le rapport risques / bénéfices d’une telle intervention.
Mais aussi toutes les autres questions spécifiques que vous vous posez.
Un neurologue. C’est le spécialiste du système nerveux (cerveau, moelle épinière et nerfs).
Un neurochirurgien. Il est le chirurgien spécialisé dans les opérations du système nerveux.
Il existe une filière santé maladies rares qui s’occupe des maladies rares du système nerveux central, et qui traite les cavernomes : Brain Team. Pour savoir ce qu’est une filière de maladies rares, mieux connaître Brain Team et identifier ses centres de prise en charge, rendez-vous sur notre article de blog : à qui s’adresser en cas de maladie rare du système nerveux central.
Le plus souvent, cette malformation ne provoque aucun symptôme. Quand le cavernome se manifeste, c’est généralement sous la forme de crises d’épilepsie, qui sont souvent récurrentes, fréquentes et parfois résistantes aux médicaments antiépileptiques. Il peut aussi être à l’origine de divers troubles neurologiques comme des maux de tête parfois violents, des vertiges, des troubles de la vision, de la parole, de la sensibilité ou de la motricité au niveau des membres. Ces manifestations varient selon la taille et la localisation du cavernome.
Le médecin diagnostique la présence d’un ou plusieurs cavernomes en pratiquant une IRM cérébrale. Du fait de l’aspect très caractéristique du cavernome, le diagnostic ne présente pas de difficulté particulière. L’IRM permet également de détecter si le cavernome a déjà entraîné un saignement.
Le choix du traitement d'un cavernome dépend :
La chirurgie est le seul traitement curatif des cavernomes. Mais comme l’intervention n’est pas anodine, le chirurgien n’intervient que si le cavernome provoque des saignements fréquents, s’il entraîne des crises d’épilepsies ou des troubles neurologiques, ou si sa taille a augmenté. Il faut également que le cavernome soit accessible, pour éviter tout risque de dommages dans le cerveau. Le but de l’intervention est de retirer totalement le cavernome. Elle est réalisée sous anesthésie générale. Le chirurgien repère précisément la localisation du cavernome, parfois à l’aide d’un système informatisé appelé «neuronavigation» (sorte de GPS du cerveau). Puis il incise successivement la peau, l’os, et les méninges (c’est-à-dire l’enveloppe du cerveau). Arrivé à ce stade, il peut retirer le cavernome. Lorsque le cavernome se situe dans une zone éloquente du cerveau, l’intervention peut se dérouler en condition éveillée pour limiter le risque de déficit neurologique postopératoire.
Lorsque la chirurgie d’exérèse du cavernome n’est pas envisageable, le chirurgien peut proposer un traitement par radiochirurgie. Cela consiste à appliquer une dose de rayons ciblés sur le cavernome de manière non invasive. Cependant, l’efficacité de cette méthode ne fait pas l’unanimité auprès des médecins, et elle peut entraîner certaines complications.
Depuis peu, la technologie laser (LITT) est disponible en France. Elle permet de traiter des cavernomes non accessibles à une chirurgie standard. Elle consiste en l’insertion d’une sonde laser dans le cavernome à l’aide de techniques de précision (stéréotaxie). La procédure de destruction du cavernome se fait alors sous IRM. La lumière laser va permettre une montée en température du cavernome et sa destruction (thermoablation). Le contrôle en temps réel par IRM permet de détruire le cavernome sans endommager le cerveau sain alentour. Bien que cette technologie devrait se développer dans les années à venir, à l’heure actuelle, seuls quelques centres en France pratiquent la chirurgie par laser.
Les médicaments sont inefficaces sur les cavernomes, mais permettent, selon les cas, de traiter les crises d'épilepsie et les maux de tête.
Enfin, dans certaines situations, notamment en l’absence de symptôme, le médecin privilégie une simple surveillance.

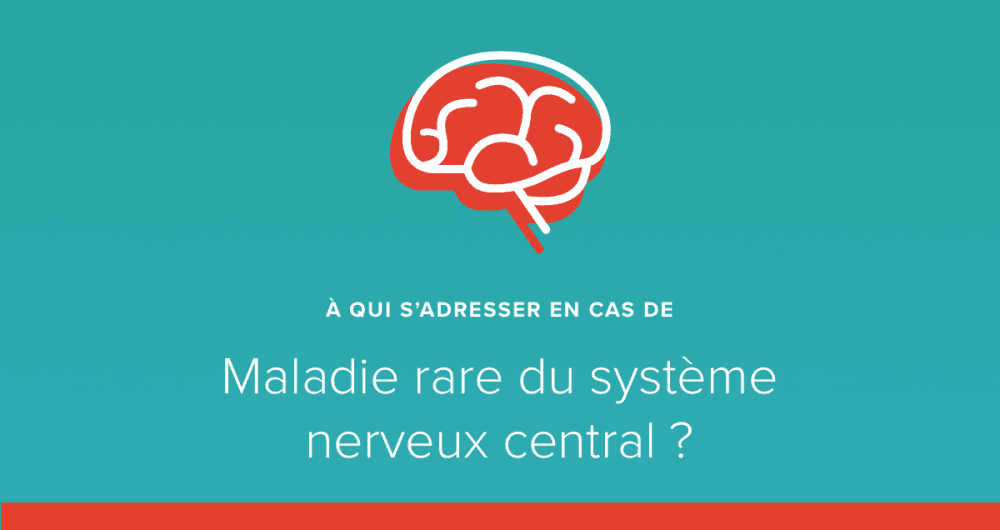
Maladie rare, maladie orpheline
A qui s'adresser en cas de maladie rare du système nerveux central ?Par Joséphine de Becdelièvre le 13/12/2018

