
Glioblastome
Ajoutée le 15/10/2025
Qu'est-ce que le glioblastome ?
Le système nerveux est divisé en deux parties : le système nerveux central, qui contient le cerveau et la moëlle épinière qui sont enfermés dans les méninges et qui baignent dans le liquide cérébro-spinal, et le système nerveux périphérique, qui contient les nerfs crâniens et spinaux et leurs ganglions nerveux. Le cerveau est enfermé dans la boite crânienne ; la moelle épinière est enfermée dans la colonne vertébrale ; les nerfs périphériques sortent de la boite crânienne et de la colonne vertébrale pour aller dans tout le corps.
Le système nerveux chez l’homme est composé à la fois de cellules nerveuses, les neurones, qui génèrent et transmettent l’information nerveuse, et de cellules de soutien aux neurones, les cellules gliales. Les cellules gliales nourrissent, protègent, entourent et permettent le fonctionnement des neurones. Il existe différents types de cellules gliales: les oligodendrocytes (cellules qui produisent une substance appelée myéline qui protège le neurone et facilitent la conduction nerveuse), les astrocytes (cellules qui nourrissent les neurones et facilitent la communication entre neurones), et les épendymocytes (cellules qui constituent la barrière entre le tissu cérébral et le liquide cérébro-spinal).
Le glioblastome est la tumeur cérébrale primitive la plus fréquente. Elle est très maligne (= grave) et se développe à partir des cellules gliales du système nerveux central. Cette maladie reste rare, avec 3500 cas par an en France. Elle est plus fréquemment diagnostiquée chez les hommes que chez les femmes et les patients ont le plus souvent une soixantaine d’années lors du diagnostic. Il y a très peu de facteurs favorisants la survenue des glioblastomes. On peut retenir le tabac, les prédispositions génétiques aux tumeurs, ou encore l’antécédent d’irradiation cérébrale dans l’enfance (= exposition à des rayonnements ionisants pour le traitement d’une maladie hématologique).
Quel est l'intérêt d'un deuxième avis pour le glioblastome ?
Le glioblastome est une pathologie rare et grave qui nécessite une prise en charge rapide par une équipe spécialisée qui offrira une prise en charge globale (accès la chirurgie et à ses différents modalités, accès à une réunion de concertation pluri-disciplinaire, accès aux solutions de radiothérapie et de chimiothérapie, accès aux traitements innovants).
Prendre un deuxième avis est essentiel avant d’avoir débuté la prise en charge thérapeutique. S’il est difficile de modifier une prise en charge déjà en cours, un avis pris en amont peut aisément la ré-orienter ou l’améliorer.
Un deuxième avis peut être proposé :
- Afin de relire une IRM cérébrale dans le cadre de la démarche diagnostique pour donner au patient une certitude sur le diagnostic.
- pour s’assurer que la prise en charge thérapeutique proposée est la plus adaptée possible.
- pour s’assurer que le glioblastome n’est pas accessible à la chirurgie car la résection est un facteur pronostique majeur.
- pour s’assurer que la chirurgie proposée correspond aux plus hautes exigences de qualité et que les techniques mises en œuvre correspondent aux standards actuels.
Quelles questions poser dans le cadre d'un deuxième avis ?
-
Quels sont les symptômes d’un glioblastome?
-
Vais-je mourir d’un glioblastome?
-
Quel est mon pronostic et ma durée de survie ?
-
Comment prendre en charge mon glioblastome?
-
Quels examens réaliser si j’ai une suspicion de glioblastome?
-
Est-ce que la transmission d’un glioblastome est génétique?
-
Quels sont les facteurs de risque d’un glioblastome?
-
Qui consulter pour mon glioblastome?
-
Est-ce que la prise en charge que l’on me propose est adaptée ?
-
Est-ce que mon glioblastome est opérable ?
-
Est-ce que l’équipe qui me prend en charge est spécialisée ?
Quels sont les spécialistes du glioblastome ?
Pour la prise en charge chirurgicale dans le cadre du glioblastome, il faut consulter en premier lieu un neurochirurgien spécialisé en neuro-oncologie qui soit un spécialiste des tumeurs du système nerveux et qui possède une large expérience. Le neurochirurgien pourra répondre à la premiere question de la prise en charge à savoir si la tumeur est accessible à la chirurgie de résection ou s’il faut se limiter à une biopsie.
Ensuite, il faut également consulter un neuro-oncologue ou un oncologue spécialisé en neuro-oncologie ou un onco-radiothérapeute qui se chargera de la suite de la prise en charge post-opératoire avec la mise en place des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. Le suivi sera assuré selon le protocole établi dans le centre vous prenant en charge (soit par le neurochirurgien, soit par le neuro-oncologue, soit de concert). Le neuro-pathologiste, qui réalisera les analyses sur la biopsie, sera contacté par le neurochirurgien et le neuro-oncologue.
Quels sont les examens à transmettre ? (obligatoires et facultatifs)
Les examens à transmettre sont :
- les courriers médicaux initiaux expliquant la situation clinique (facultatif)
- L’IRM cérébrale montrant la tumeur (obligatoire)
- Le scanner cérébral s’il a été réalisé (facultatif)
- Les résultats de l’analyse anatomo-pathologique si la biopsie a déjà été effectuée (facultatif)
On rappelle ici l’importance de prendre un avis le plus précocémment possible, idéalement avant le geste chirurgical pour vous assurer que la proposition de traitement est adaptée à la situation.
Quels sont les symptômes du glioblastome ?
Il existe différents symptômes chez les patients atteints d’un glioblastome. Ils diffèrent en fonction de la taille et de la localisation tumorale. Parmi les différents symptômes, le patient peut ressentir des céphalées (= maux de tête), avoir des nausées, vomir, présenter des crises d’épilepsie (= perte de connaissances avec convulsions). Si la tumeur est localisée dans certaines zones spécifiques du cerveau, il est possible que le patient présente une difficulté à coordonner ses mouvements, à parler, ou à voir. Il peut aussi présenter des troubles de la mémoire et du comportement.
Comment diagnostiquer le glioblastome ?
Le diagnostic d’un glioblastome se fait en plusieurs temps. Tout d’abord, un examen clinique neurologique est réaliser pour établir le retentissement clinique. Durant cette première étape, différentes hypothèses diagnostiques sont posées. L’examen clinique permet de comprendre la chronologie d’apparition des symptômes et d’évaluer les grandes fonctions neurologique : force musculaire, sensibilité, langage, mémoire, audition et vision. Cette étape permet d’éliminer certains diagnostics différentiels qui peuvent donner des symptômes similaires.
Dans un deuxième temps, un examen d’imagerie est demandé afin de confirmer la suspicion diagnostique. Dans le cadre du glioblastome, l’IRM cérébrale est l’examen de référence. Elle peut être précédée d’un scanner cérébral qui oriente le diagnostic mais qui n’est pas suffisant. L’IRM cérébrale est réalisée en séquences morphologiques (T1, T2, FLAIR, sans et avec injection de produit de contraste = le gadolinium) et elle peut également comporter des séquelles supplémentaires (Diffusion, T2*, Perfusion, Spectroscopie). L’examen IRM permet de localiser et de mesurer la tumeur et d’éliminer certains diagnostics différentiels comme l’accident vasculaire cérébral.
Enfin, le diagnostic de certitude de glioblastome nécessite un prélèvement de la tumeur qui est réalisée au bloc opératoire au cours d’une intervention neurochirurgicale qui peut se limiter au prélèvement (on parle alors de biopsie) ou au cours d’une chirurgie pour retirer la tumeur (on parle alors de résection ou d’exérèse). Le prélèvement tumoral est adressé au laboratoire d’anatomo-pathologique pour une double analyse histopathologique (= analyse des tissus au microscope) et histo-moléculaire (= analyse des caractéristiques génétiques et moléculaire). Cette étape d’analyse, - qui peut durer plusieurs semaines - permet de poser le diagnostic formel de glioblastome (= astrocytome de grade 4 sans mutation IDH) et d’en déterminer sa « carte d’identité » (= sous type tumoral, son degré d’agressivité).
Comment traiter le glioblastome ?
L’arsenal thérapeutique des glioblastomes est multiple (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, champs électriques externes). Le choix des traitements et leur séquence est établi en réunion de Concertation Pluri-Disciplinaire.
Le premier traitement est toujours un geste chirurgical. Si le glioblastome n’est pas opérable (lésion trop profonde ou trop étendue, patient trop fragile), la chirurgie se limitera à un geste de biopsie (biopsie stéréotaxique, biopsie neuronaviguée). Si le glioblastome est opérable, c’est à dire que l’on peut en retirer une très large partie en prenant un risque modéré, la chirurgie de résection sera proposée car c’est le traitement de référence des glioblasomes. Le but de la chirurgie de résection est de réséquer le maximum de tissu tumoral sans léser le tissu cérébral nécessaire au fonctionnement du patient. Pour ce faire, différentes techniques d’aide à la chirurgie doivent être mises en œuvre par le neurochirurgien (neuronavigation IRM, microscope opératoire, fluorescence per-opératoire, cartographie fonctionnelle per-opératoire en conditions éveillées). L’objectif de la chirurgie est de retirer la partie charnue la plus agressive du glioblastome et il est rare que le chirurgien puisse réséquer la portion la plus périphérique du glioblastome au vu de son caractère très infiltrant dans le cerveau avoisinant. La chirurgie de résection permet aussi de réaliser des prélèvements de biopsie tumorale. Elle permet enfin de déposer dans la cavité opératoire, au plus près d’éventuelles cellules tumorales résiduelles, une chimiothérapie in situ, sous la forme d’implants (qui s’apparent à des pastilles que l’on fera fondre sous la langue) qui diffusent une chimiothérapie durant plusieurs semaines.
Après la chirurgie, le traitement de référence du glioblastome comprend une radiothérapie associée à une chimiothérapie par du Témozolomide (Témodal) avec une séquence bien définie selon un protocole international : radiothérapie avec chimiothérapie concomitante pendant 6 semaines puis pause d’un mois puis chimiothérapie seule adjuvante durant 6 mois. La radiothérapie consiste à appliquer des radiations sur les zones cérébrales contenant la tumeur afin de détruire les cellules de glioblastomes, celles-ci étant plus fragiles que les cellules saines qui, elles, arrivent à résister à la radiothérapie. La chimiothérapie est un traitement systémique (= qui circule dans tout le corps) qui vise aussi à tuer les cellules tumorales restantes et à limiter les récidives. La chimiothérapie utilisée dans cette pathologie doit franchir la barrière hémato encéphalique, (= barrière qui protège le cerveau de certains agents qui circulent dans le sang) et elle s’appelle Témozolomide.
Après la radiothérapie et durant la période de chimiothérapie adjuvante, le patient peut recevoir un traitement supplémentaire consistant en l’application d’un champ électrique externe continu (= tumor-treating field) dans son cerveau afin d’empêcher les cellules tumorales de se multiplier. Ce traitement est appliqué par des électrodes collées à la surface du crâne qui doit être rasé, les électrodes devant êtres portées au moins 17 heures par jour.
Obtenez l’avis d’un médecin spécialisé de votre problème de santé en moins de 7 jours
Voici l’un des médecins référencés pour cette maladie

Pr Johan Pallud
Neurochirurgien
Centre Hospitalier Sainte-Anne
Grâce à votre contrat santé ou prévoyance, obtenez l’avis d’un médecin référent de votre problème de santé en moins de 7 jours, gratuitement et sans avance de frais

Découvrez nos conseils santé sur notre blog chaque semaine


Ménopause
Quelles solutions pour traiter naturellement les symptômes de la ménopause ?Par Dorothée Berthon le 20/01/2026

Les coulisses de deuxiemeavis.fr
Trois minutes avec Capucine, Chargée de Marketing Digital Junior chez deuxiemeavis.fr.Par Hortense Fisset le 19/01/2026
Découvrez nos webinaires
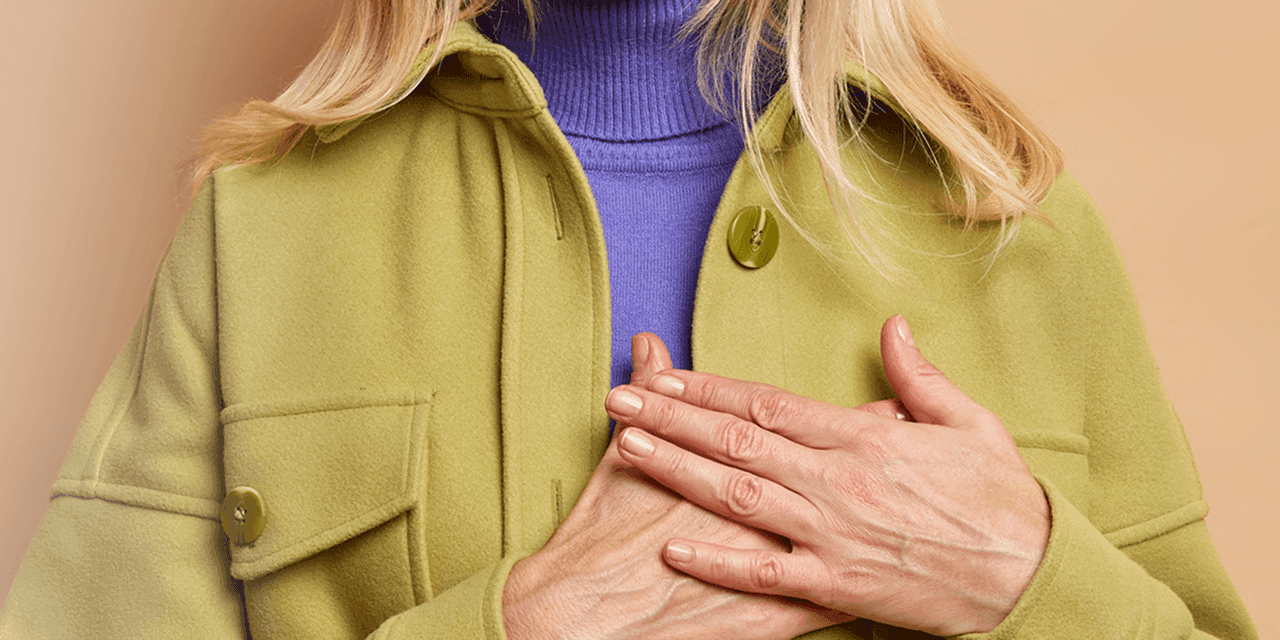
Maladies cardiovasculaires : un cœur sur deux à risque sans le savoir
Vous avez manqué un webinaire ?
Tumeurs et cancers du système nerveux :
- Kyste colloïde du troisième ventricule
- Méningiome
- Métastase(s) cérébrale(s)
- Tumeur cérébrale
- Tumeur de la moelle épinière
- Tumeur intradurale extramédullaire
- Méningiome rachidien
- Schwannome
- Neurinome de l’acoustique
- Neurinome rachidien
- Neurofibromatose
- Neurofibromatose - Diagnostic génétique
- Gliome
- Hémangioblastome
