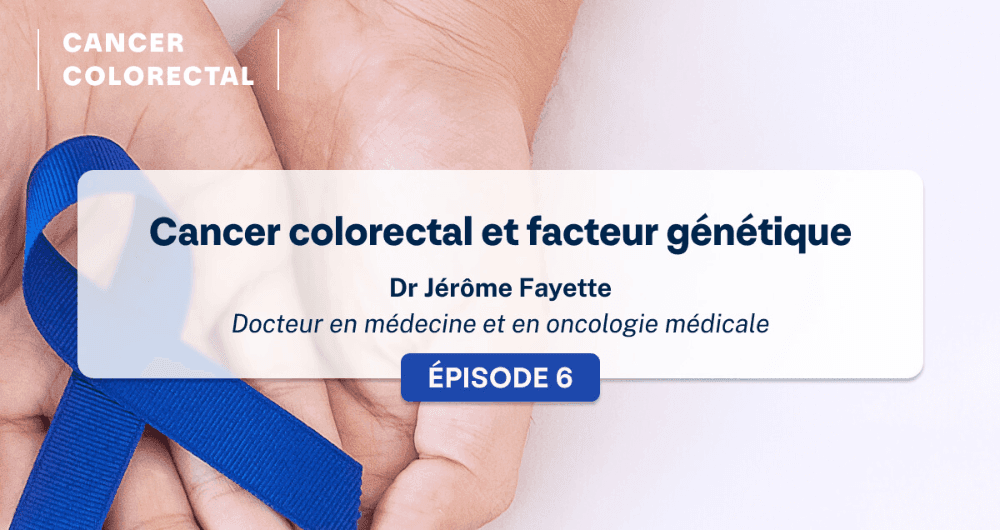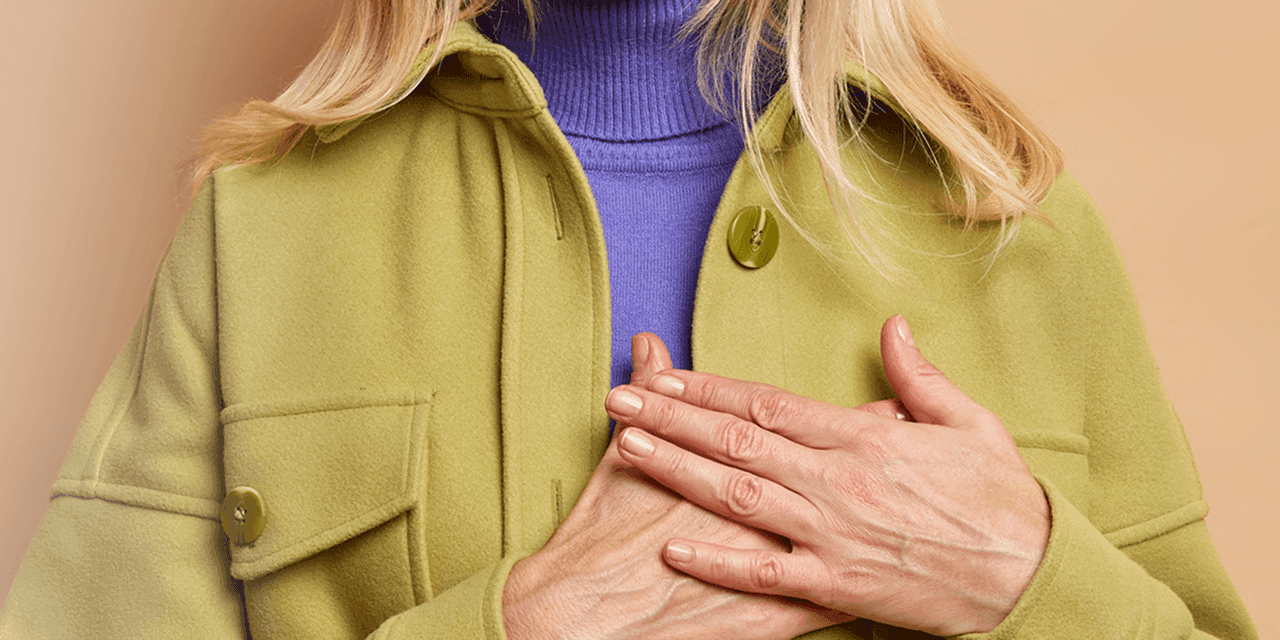Webinaires
Cancer colorectal : de la prévention à la guérison. Retour sur notre webinairePar Hortense Fisset le 05/06/2024
Revue par le Pr Thierry André, Oncologue
Mise à jour le 03/10/2025
Le choix du traitement dépend :
La chirurgie constitue le traitement principal du cancer du rectum, et consiste à enlever la tumeur avec son enveloppe (le mesorectum) avec une marge de tissu sain. L’intervention peut se faire par laparotomie (ouverture du ventre), par cœlioscopie (opération « ventre fermé » avec utilisation de caméra) ou par robot ou par abord transanal (via l’anus). La tumeur peut s’étendre aux organes voisins (vessie, urètre, prostate, ovaires, vagin ou utérus). Le chirurgien peut alors enlever en même temps les organes voisins touchés et les ganglions lymphatiques proches. Si les métastases ne peuvent pas être opérées du fait de leur nombre ou de leur inaccessibilité, des traitements médicaux sont proposés.
La radiothérapie ainsi que la chimiothérapie peuvent être proposées avant la chirurgie afin de réduire la taille de la tumeur, voir dans certains cas de la faire disparaître (chimiothérapie et ou radio-chimiothérapie néoadjuvante) et augmenter les probabilités de guérison. La radiothérapie est le plus fréquemment la radiothérapie externe (à travers la peau) associée ou non à des comprimés de chimiothérapie. Plus rarement la curiethérapie (radiothérapie interne, des éléments radioactifs sont directement implantés au contact de la tumeur ou au sein de la tumeur) est indiquée, parfois associées à la radiothérapie externe.
En cas de métastase(s) ganglionnaire(s) retrouvés sur la pièce opératoire du cancer retiré par le chirurgien, une chimiothérapie adjuvante doit être proposée après la chirurgie. Dans ce cas, le risque de rechute (survenue de métastases et/ou plus rarement rechute locorégionale) existe et le bénéfice d’une chimiothérapie adjuvante est important car il permet d’augmenter le nombre de patients guéris.
En cas de métastase(s) à distance, la chimiothérapie et les thérapies ciblées sont les traitements médicaux généraux identiques à ceux du cancer du côlon qui opèrent sur l’ensemble du corps et atteignent les cellules cancéreuses où qu’elles soient. Alors que la chimiothérapie agit sur les mécanismes de la division cellulaire, les thérapies ciblées bloquent des mécanismes spécifiques des cellules cancéreuses.
La chimiothérapie est souvent composée d’une association de médicaments dont le mécanisme d’action est différent, dans le but de multiplier les effets et de diminuer les résistances des cellules cancéreuses.
Parmi les nouveaux médicaments utilisés au stade métastatique de la maladie (médicaments mis sur le marché depuis moins de 15 ans), sont arrivées les thérapeutiques moléculaires ciblées. On n’inclut pas dans les thérapies ciblées les immunothérapies qui sont rarement indiquées dans le cancer du rectum sauf si le cancer du rectum se développe dans le cadre d’un syndrome de Lynch et ou s’associe une anomalie de réparation de l’ADN et que la tumeur est Microsatellite instable (MSI).
Les « thérapies ciblées » sont de nouvelles familles de produits dirigés contre une cible moléculaire, qui visent à freiner ou à bloquer la croissance de la cellule cancéreuse. Ils se divisent en deux grandes classes, les anticorps monoclonaux, qui inhibent les récepteurs membranaires ou circulants et les petites molécules qui inhibent la signalisation intracellulaire. De plus en plus souvent, grâce aux progrès de la recherche, en particulier de la biologie moléculaire et de la génétique, on peut traiter plus efficacement en proposant un traitement personnalisé, adapté à chaque patient et à sa tumeur. Il est donc nécessaire, pour définir au mieux les traitements, d’avoir le compte rendu anatomo-pathologique et de biologie moléculaire d’un fragment de la tumeur obtenu par biopsie ou à partir de la tumeur retiré chirurgicalement. La biologie moléculaire (avec résultats de la présence ou l’absence de mutation des gènes RAS et RAF) ainsi que l’immuno-histochimie (besoin de connaître la présence ou l’absence des protéines du système MMR) permettent non seulement de découvrir de nouvelles cibles et de nouveaux médicaments mais aussi de sélectionner un traitement actif.

Oncologue
Hôpital Saint-Antoine (APHP)

Radiothérapeute Oncologue
Institut Bergonié (CLCC)

Chirurgien viscéral et digestif
Centre Léon Bérard (CLCC)

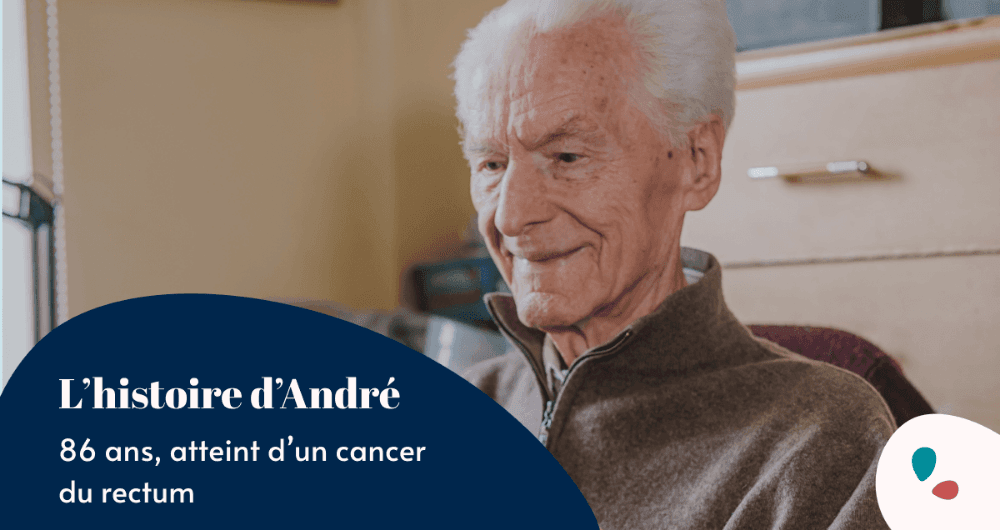
Témoignages
L'histoire d'André, 86 ans, atteint d'un cancer du rectumPar Hortense Fisset le 11/03/2024
Site parfait pour prendre une décision médicale en toute Indépendance. Réponse rapide et professionnelle. Je recommande
Fred
Très bon accueil, très bonne écoute, les conseils donnés ont ouvert des possibilités de prise en charge intéressantes, merci beaucoup.
Denis

Webinaires
Cancer colorectal : de la prévention à la guérison. Retour sur notre webinairePar Hortense Fisset le 05/06/2024

Webinaires
Le cancer colorectal : l’importance de la préventionPar Capucine de la Brosse le 10/04/2024